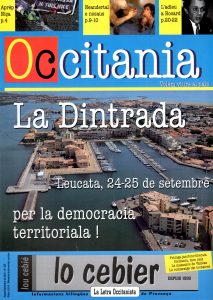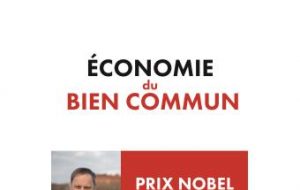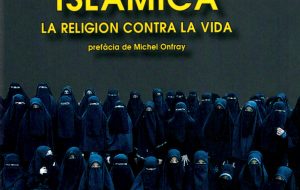Après la mort de Michel Rocard… et les nombreux éloges unanimes (!) et souvent hypocrites qui lui sont faits, il est bon, semble-t-il de rappeler qu’il fut secrétaire national du PSU (de 1967 à 1974), à une époque où ce parti définissait le socialisme autogestionnaire, prônait «le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes», combattait le colonialisme intérieur comme extérieur, luttait contre le centralisme étatique et pour l’autonomie des nations sans Etat.
Rocard fut d’ailleurs l’auteur d’un rapport intitulé « Décoloniser la province » aux rencontres de Grenoble en 1967 sur « La vie régionale en France », un rapport où il fustige « une tradition politique qui, des rois aux républiques, en passant par les empereurs, gouverne à l’intérieur par ses missi dominici, ses intendants et ses préfets en étouffant les pouvoirs locaux» et où il affirme que « la renaissance du dynamisme régional suppose la disparition de la tutelle de l’Etat et du préfet »…
C’était aussi l’époque de luttes sociales exemplaires, ouvrières avec l’affaire Lip et paysannes avec l’affaire du Larzac, et c’était enfin la prise de conscience par nos populations d’une appartenance à une terre, à une langue et à une culture, ce qui se traduisait par ce slogan toujours d’actualité: «Volèm viure, trabalhar et decidir al païs»!
Héritier de Mendes-France, Michel Rocard fut sans doute le seul Premier ministre de la Ve république à bien comprendre l’Histoire des peuples et de leurs nations, à dire et à montrer la nocivité du centralisme parisien et de cette vieille formule dépassée d’une « république une et indivisible », dont on sait tous les dégâts qu’elle a pu causer dans notre Histoire, avec l’Algérie en particulier. C’est pourquoi il a su résoudre par la négociation le grave problème de la Nouvelle Calédonie entre autres, alors que d’autres étaient prêts à faire massacrer toute une population autochtone au nom de «l’un et de l’indivisible» pour que «force reste à la loi de Paris» …
C’est peut-être son éducation protestante par sa mère et ses références à l’Edit de Nantes qui l’ont conduit à pratiquer en maintes occasions une politique de tolérance, avec tout ce que ce mot comporte de respect des libertés d’autrui et de compromis pour « vivre ensemble ». On retrouvera ce trait de caractère dans son ouvrage « L’art de la paix, l’Edit de Nantes » écrit en 1997 en collaboration avec l’historienne et universitaire toulousaine Janine Garrisson, qui dit de la Révocation de cet édit par Louis XIV en 1685: « C’est une décision politique, relevant de ce que l’on appelle de nos jours le totalitarisme ». Or avec Henri de Navarre, les protestants avaient réussi à imposer une conception de la laïcité qui n’a rien à voir avec le sectarisme, dont les militants de tous bords et notamment de l’extrême droite mais aussi de l’extrême gauche voudraient la définir.
Michel Rocard restera aussi l’homme politique le plus clairvoyant sur la question corse… et ce n’est sûrement pas un hasard s’il a voulu, lui le Parisien de naissance, que ses cendres reposent sur cette terre méditerranéenne de «l’Île de Beauté».
Ironie du sort: quelques jours après la mort de Rocard, l’actuel Premier ministre, le plus jacobin peut-être que nous ayons connu, se déplaçait en Corse avec une kyrielle de ministres plus centralistes les uns que les autres pour dire aux Corses, ce qu’ils disent à tous les peuples de la république: «L’Etat c’est nous! Vous n’existez pas et il n’y a rien à négocier…».
Alors pour rafraîchir la mémoire de Manuel Valls, émigré de Catalogne, nous lui dédions l’article que Michel Rocard (son « père politique » dit-il !) a publié dans le quotidien «Le Monde» du 31 août 2000 sur la Corse, un article qui pourrait tout aussi bien convenir aux autres nations de l’Hexagone et de l’Outre-mer.
On pourra aussi écouter le « discours de Rocard sur la Corse » à la tribune de l’Assemblée Nationale, en se connectant sur « You Tube ».
Georges Labouysse
Corse : Jacobins, ne tuez pas la paix !
par Michel Rocard – député européen, ancien premier ministre
le Monde – 31 août 2000
Extraits
[…]
Je n’ai pas une goutte de sang corse mais je n’aime pas que l’on me raconte des histoires, fût-ce au nom de mon pays. Je suis, amis jacobins, aussi fier que vous, sinon davantage car, député européen, j’évalue mieux la force comme les différences par rapport à nos concitoyens d`Europe ou du monde, des principes qui ont fait la République française et qui scellent son unité. Mais les principes fondamentaux de la République française se veulent libérateurs, et non oppressifs.
Le droit à la résistance à l’oppression est même un des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen. Car il y a eu oppression, et il en reste de fortes traces. Je suis pour l’application des principes, mais pas au prix de l’oubli total du passé.
Il y a une révolte corse. On ne peut espérer la traiter sans la comprendre.
Il faudrait tout de même se rappeler :
– que lorsque Louis XV acheta les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, il fallut une guerre pour prendre possession de notre nouveau domaine. La France y perdit plus d’hommes que pendant la guerre d’Algérie.
– que la Corse est restée » gouvernement militaire » jusque tard dans le XIXe siècle, avec tout ce que cela implique en termes de légalité républicaine.
– que, pendant la guerre de 1914-1918, on a mobilisé en Corse, ce qu’on n’a jamais osé faire sur le continent, jusqu’aux pères de six enfants.
– que, de ce fait, encore en 1919, il n’y avait pratiquement en Corse presque plus d’hommes valides pour reprendre les exploitations agricoles. Les tout jeunes n’ont pas eu le temps de recevoir la transmission des savoir-faire. C’est ainsi qu’ils sont devenus postiers et douaniers.
– que c’est donc à ce moment que la Corse devient une économie assistée, ce qu’elle n’était pas auparavant. L’apparition de la « paresse corse » dans les blagues, les chansons et le folklore datent de là. On n’en trouve pas trace avant.
– que, d’autre part, le droit successoral traditionnel corse était fort différent du code civil. C’est ainsi que les « métropolitanisés », si j’ose dire, Corses ou non-Corses, se sont injustement appropriés, bien des terres ancestrales. C’est aussi la raison principale pour laquelle beaucoup d’agriculteurs corses traditionnels n’ont pas de titres de propriété leur permettant d’obtenir du crédit.
– que, de la même façon, le code civil ne prévoit pas, et interdit même, la propriété collective. Or tout l’élevage corse, et notamment celui des porcs – la charcuterie corse est justement célèbre -, se faisait sur terres de pacage collectives.
– que la tuerie d’Aléria, les 21 et 22 août 1975, a été ressentie comme la fin de tout espoir d’une amélioration consécutive à des discussions avec le gouvernement de la République et a donné le signal du recours à la violence, parce que tous les Corses, je crois sans exception, ont très bien compris que jamais une riposte pareille à une occupation de ferme n’aurait pu avoir lieu dans l’Hexagone.
– que, d’ailleurs, treize ans auparavant, la Corse avait reçu du gouvernement français un autre signal dangereux. Suite à des incidents survenus, déjà, à la fin des années 50, le gouvernement créa la Société de mise en valeur de la Corse, Somivac. Elle avait charge de racheter des terres disponibles, en déshérence ou non, de les remembrer, d’y tracer voies et chemins, d’y amener l’irrigation dans certains cas, puis de les revendre à des paysans corses. Les quatre cents premiers lots furent prêts à la vente au tout début 1962. De Paris vint l’ordre d’en réserver 90 % pour les pieds-noirs rentrant d’Algérie. 90%, pas 15% ou même 50%! Ce pourcentage est une incitation à la guerre civile.
– que l’on fit, en 1984, une découverte étrange. Le président Giscard d’Estaing, vers 1976 ou 1977, avait pris la sage décision d’assurer à la Corse la « continuité territoriale », c’est-à-dire la prise en charge par l’Etat de tout surcoût de transport lié à son insularité. Sept ou huit ans après – est-ce stupidité, manque de courage ou concussion? -, l’administration avait assuré la continuité territoriale pour les transports de personnes et pour les transports de marchandises de l’Hexagone vers la Corse, mais pas dans le sens inverse! Les oranges corses continuaient d’arriver à Marseille avec des frais de transport plus élevés que celles qui venaient d’Israël. Pour les vins et la charcuterie, ce fut la mort économique.
– et qu’enfin la Corse, comme la Martinique et la Guadeloupe, a subi pendant bien des décennies un monopole de pavillon maritime imposé par l’Etat, avec les conséquences asphyxiantes que l’on devine.
[…] Lorsque l’Histoire a un tel visage, il faut soit beaucoup d’inconscience, soit beaucoup d’indécence pour dire seulement aux Corses : » Assez erré maintenant. Soyez calmes et respectez les lois de la République. Vous bénéficierez alors pleinement de leur générosité. » De cette application uniforme et loyale, les Corses n’ont guère vu trace dans leur longue histoire.
[…]En l’absence d’une véritable justice foncière, c’est la violence qui est devenue l’instrument de défense des droits personnels, et la loi du silence, l’omerta, la traduction inévitable de la solidarité familiale devenue clanique. On est vite passé de la terre à l’ensemble des activités sociales. De plus, là comme ailleurs en France, l’Etat distribue des subventions, puisque chez nous, au lieu d’être pour l’essentiel utilisés sur place comme dans les Etats fédéraux, les produits de notre fiscalité remontent au centre avant d’en retomber pour attester la générosité de la République. Dans un univers culturel où la légalité et l’équité étaient aussi peu apparentes, il n’est guère surprenant que les clans se soient organisés, violence et loi du silence comprises, pour contrôler à tout prix les processus électoraux et les flux financiers qu’ils induisent.
Voilà le gâchis dont il faut maintenant sortir. […]
Comment traiter alors cette nécessité pour la Corse de prendre une part plus grande à la maîtrise de ses affaires pour les conduire en fonction de ses caractéristiques propres ? Le fait que l’on ait pu évoquer et citer dans le projet gouvernemental des « attributions législatives » a suffi à mettre le feu aux poudres. […]
Si vraiment l’on croit, comme l’affectent nos jacobins, et comme je le crois moi-même, aux vertus exclusives de l’action politique et de la démocratie pour assurer à la Corse un avenir de calme et d’expansion, alors pourquoi vouloir en exclure les Corses eux-mêmes ? Le pari qui s’esquisse consiste à penser que les Corses fiers de l’être et qui revendiquent leur identité, une fois devenus plus nettement responsables, sauront traiter des difficultés d’existence de cette identité mieux qu’il n’a été fait par le passé. Refuser ce pari, c’est refuser la démocratie dans son principe. Refuser de donner une large autonomie à l’Assemblée de Corse c’est d’abord faire le calcul surprenant que les nationalistes pourraient y être bientôt majoritaires, ce que tout dément, mais surtout afficher clairement que l’on se méfie d’eux, que l’on ne croit ni à l’apprentissage de la responsabilité ni aux vertus des réconciliations négociées.
Lionel Jospin a eu un grand courage dans cette affaire. Il serait dommage et dangereux qu’une frilosité républicaine bornée l’empêche d’établir entre la France et la Corse de nouvelles relations fondées sur la confiance réciproque. La République en sortirait à coup sûr renforcée, alors que la persistance de la crise l’affaiblit gravement.
Michel Rocard