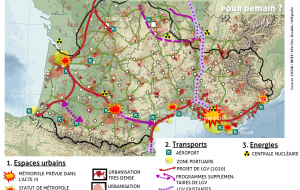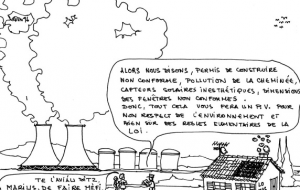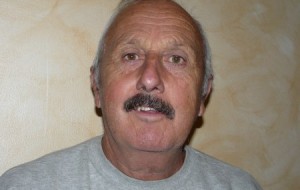L’eau est indispensable à la survie de l’humanité. Non l’eau des océans qui couvrent 70% de la planète
mais l’eau douce, à peine 3% de l’eau sur terre. Mais elle a été tellement gaspillée, polluée, qu’elle
devient un bien rare que les êtres humains sont prêts à se disputer à coups de milliards d’abord, de
guerres peut-être ensuite. Les ressources du sol et du sous-sol ont été dilapidées au profit de quelquesuns.
Et ce sont les mêmes qui après avoir organisé la rareté du bien commun extraient de nouveaux
bénéfices du manque ainsi créé. Face à ce ballet mondial des multinationales, les citoyens sont peu de
chose. Ils ont pourtant le pouvoir de mettre quelques grains de sable dans l’engrenage de la machine.
L’agriculture : 92% de l’eauconsommée dans le monde
L’eau commence à manquer, en qualité mais aussi en quantité.
En qua lité, car nous avons dévers é dans les cours d’eau et les nappes tous les effluents de l’agriculture productiviste et de l’industrie. En quantité, car nous avons drainé les zones humides, irrigué des cultures inadaptées au sol et au climat, mult iplié la gabegie de la consommation individuelle, choisi les énergies les plus gourmandes en eau et l’alimentation carnée plutôt qu’à base de céréa les (Il faut 1500 l d’eau pour un kilo de viande de boeuf contre 800 l pour un kilo de céréales).
Le dérèglement du climat dû à notre product ion de GES en constante augmentation provoque inondations et sècheresses sévères. Les glaciers régressent, les calottes polaires fondent, libérant du méthane qui accentue le réchauffement. En même temps, les nappes profondes d’eau non renouvelable sont tellement mises à contribution que certaines sont asséchées ou en voie de l’être.
Les « révolutions vertes » lancées dans de nombreux pays dans les années 60 pour nourrir la population et produire des excédents exportables ou simplement pour arriver à l’autosuffisance alimentaire comme en Inde ou en Chine sont la cause principale de l’épuisement des ressources en eau. À base d’irrigation et d’utilisation massive d’intrants, cette agriculture intensive pollue les nappes superficielles et profondes, tout en les absorbant par surpompage, sans prévoir leur renouvellement. Et comme le climat se réchauffe, l’apport des précipitations ne suffit plus à reconstituer les r éserves .
En Inde, en Chine, en Australie, aux Éta ts- Unis, les nappes phréatiques s’effondrent. Une pénurie d’eau est annoncée pour de nombreux pays en 2 025. Le Yémen pourrait être le premier pays sans eau.
Face à cette menace, que font les États ?
Certains adoptent des mesures. En Australie, une police de l’eau oblige les gens à perdre leurs habitudes de gaspillage, on dessale l’eau de mer, on recycle les eaux usées même pour la boisson. En Inde, des pratiques culturales importées de Madagascar permettent d’économiser 30 à 50% d’eau dans les rizières. Mais on ne remet pas en cause le s ys tème a gricole dominant , on refuse de revenir à la gestion tradit ionnelle de l’eau par les communautés paysannes qui savaient respecter l’équilibr e écologique du milieu et préserver la ressource. On assiste plutôt à une course en avant pour dila pider ce qui res te.
Les États-Unis, comme le Mexique, comptent accéder par pipe-line aux réserves d’eau du Canada (7% de l’eau douce mondiale), ce que les Canadiens, eux-mêmes un des plus gros consommateurs de la planète, refusent absolument. Chine, Inde et Pakistan se disputent l’eau de l’Himalaya à coups de barrages.
Dans les régions du monde où l’eau abonde encore, l’agrobusiness impose des monocultures à usage multiple (alimentation humaine, fourrage, carburant,…) consommant dix fois plus d’eau que l’agroécologie.
Ailleurs, des pays riches achètent des terres aux pays pauvres avec accès illimité à l’eau, car non règlementé, pour prat iquer une agriculture intensive à bas prix. Ce faisant, ils résolvent , momentanément, leur propre déficit en eau et en terres arables. Mais ils détruisent les agricultures locales et les communautés, polluent leurs eaux, assèchent les rivières avoisinantes, accentuant les inondations à la saison des pluies.
Le marché de l’eau
La tendance n’est donc pas à un changement de cap mais plutôt à une exploitation du manque. L’eau devient rare donc source de bénéfices énormes pour quelques-uns. Dans les discussions internationales, on pose la question de l’eau en termes de sécurité, non d’accessibilité pour tous à cette ressource. Cela permet d’empêcher les c itoyens d’exiger sa préservation et sa répartition équitable, et justifie la privatisa tion du marché.
Les mult inat ionales de l’eau — les franç aises Vivendi et Suez détiennent 7 0% de l’act ivité — imposent un modèle d’accès à l’eau basé sur le profit : pour ceux qui peuvent payer, et ceux qui consomment le plus. Elles achètent des lacs, des cours d’eau, des réserves en Argent ine, Bolivie, Ghana, Nigeria, Malaisie, pour spéculation future et même les sources pour revendre l’eau en bouteilles. Elles gèrent le traitement de l’eau, l’assainissement, le dessalement dans de nombreux pays. Des marchés locaux de droits sur l’eau existent déjà.
En Californie, les agriculteurs vendent ou achètent leurs droits par messagerie électronique.
EnAustralie, les allocat ions en eau peuvent être échangées, leur prix varie en fonction du prix des matières premières au niveau mondial, ce qui entraîne des effets pervers : les cultivateurs de blé peuvent ne pas semer une année et vendre leurs droits aux producteurs de coton si c’est plus avantageux, les petits agric ulteurs peuvent les céder aux compagnies minières plutôt que cultiver leurs terres.
Un marc hé inter na t iona l de l’eau est en passe de s’organiser pour transférer l’eau des régions où elle abonde et coûte peu, à d’autres où elle est rare et chère. L’accaparement de l’eau par le marché empêche l’organisation collective de la ressource au profit d’une gest ion privée et d’intérêts particuliers.
La résistance est possible
Des communautés rurales partout dans le monde gagnent des b atailles contre l’agr obus ines s. Par tout des communes , Da r es Salaam, Buenos aires, Hamilton, Toulouse, tout un pays, la Malaisie, optent pour une autre forme de résistance: la remunicipalisation de l’eau.
Dans l’hexagone, le privé détient encore 70% de la distribution de l’eau, mais il es t en r ec ul c onstant. D’ici à 2 015, les trois quarts des contrats de délégation du service public arriveront à échéance, c’est le moment de passer en régie pour les municipalités. En juillet 2011, le Conseil Constitutionnel a décidé que les collectivités loc ales compétentes pour l’eau potable pouvaient modifier leurs aides en fonction du mode de gest ion, public ou privé. Ils ont ainsi c onforté le Cons eil Général desLandes qui se battait depuis 15 ans contre le cartel de l’eau.
Le Sydec ( Syndica t mixte dépa rtementa l d’équipement des communes) apporte une expertise capable de conseiller les syndicats intercommunaux ou de gérer directement les régies. Là où les entreprises privées gèrent le réseau, les contribuab les paient 3 0 à 40% de trop.
À Bordeaux, Suez se voit contraint d’afficher son rendement annuel : 29% ! Seul un tiers de son budget est consacré à la remise en état des canalisations, d’où d’importantes fuites dans le réseau, un taux de plomb dans l’eau bien supérieur à la norme européenne, et un dosage massif de chlore pour la stériliser. Nul besoin d’économiser l’eau puisqu’ils la facturent.
En 2006, un avenant oblige l’entreprise à rendre 233 millions d’euros aux administrés. La ville passe en régie, cela permet de diminuer la consommation de 25%. Veolia ex-Vivendi-CGE, Suez- Lyonnaise des Eaux et Saur qui se partagent le gâteau hexagonal, préf èr ent innov er dans le c ur at if, chercher de nouvelles technologies pour traiter l’eau, toujours plus coûteuses.
Beaucoup de régies, au contraire, s’efforcent de préserver la qualité de l’eau à la source en a chetant les terres autour des zones de captage et en y favorisant des activités agricoles ou pastorales soutenables ou la plantation de forêts. Et pour économiser les ressources en eau, rien ne vaut le paiement au m3.
Depuis 2010, Libourne (33) a mis en place une tarification « sociale » et « progress is te » : 0,10 €/ m3 pour les 15 premiers m3 considérés comme vitaux, 0,7 €/ m3entre 16 et 120 m3 pour l’eau « utile », 0,75 €/ m3 de 121 à 150 m3 pour l’eau « de confort », 0,835 €/ m3 au-delà, avec en plus un cahier des charges très contraignant pour le délégataire de service public et un suivi par une régie de contrôle de l’eau.
Le droit à l’eau
Pour garantir une gestion démocratique, tous les usagers doivent négocier collectivement leur droit à l’eau et les charges dues à la pollution, s’il y a lieu. Il s’agit de faire avec la ressource disponible, l’économiser, la préserver et la distr ibuer à chac un s elon ses b esoins. Tout le contraire de ce que les multinationales de l’eau veulent imposer.
Le Forum Alternatif Mondial de l’Eau tenu à Marseille en 2012 a reconnu la nécessité de l’agroécologie, « adaptée au changement climatique, moins consommatrice de la ressource en eau et moins polluante », et de l’investissement dans « des techniques intelligentes de collecte et d’utilisation d’eau, adaptées aux capacités locales et tenant compte des savoir-faire traditionnels ». L’ONU a reconnu l’accès à l’eau comme un droit humain fondamental en 2010
. Avec plus d’un million de signatures en 2013, une Initiative Citoyenne européenne a obtenu l’inscription de ce droit et la demande d’une gestion publique de l’eau à l’ordre du jour de la Commission européenne.
Danisa Urroz